Pour se situer un peu
Le Yoga trouve originellement sa source en Inde.
Il est l’une des 6 branches de la philosophie indienne astika.
Initialement, le mot signifie « union » en sanskrit, une très ancienne langue indo-européenne.
Bien qu’aujourd’hui on connaisse et pratique principalement l’aspect physique de la discipline,
le Yoga est en réalité bien plus riche.
Il s’agit d’un système complet de développement l’individu offrant la possibilité de nous transformer sur le plan
physique, mental, et spirituel. Pour autant, chaque pratiquant n’en retirera que ce qu’il souhaite.
L’importance et la nature des bénéfices étant toujours proportionnelles à l’investissement de l’élève.
***
Quelques ouvrages de références aux auteur(s) mystérieux
Texte fondamental de l’hindouisme datant environ du 5ème siècle avant J-C, la Bhagavad Gita contient de nombreux enseignement métaphoriques du Yoga dans chacun de ses 18 chapitres.
Loin du dogme religieux, cet écrit ouvre la porte à une compréhension spirituelle de la pratique et ses différentes voies .
Plus tard, entre -200 avant J-C et l’an 500, seront écrit les Yoga Sutra de Patanjali.
A la fois synthèse et codification des enseignements du yoga, l’oeuvre repose sur l’analyse poussée de nos mécanismes psychiques.
Tout en présentant les techniques et principes pour parvenir à contrôler consciemment le mental, elle divise la discipline en huit « branches » distinctes :
Yamas et Nyamas: observances morales/éthiques
Asanas: les postures
Pranayama: exercices et contrôle de la respiration
Pratyahara: le retrait des sens des objets
Dharana: la concentration
Dhyana: la méditation
Samadhi: état de béatitude, d’illumination permanente, union avec le divin
(traduction approximative et non exhaustive)
Ensemble ces 8 éléments constituent l’Ashtanga (ash=8 anga= branches) ou le RajaYoga (la voie royale).
(A ne pas confondre avec l’Ashtanga Vinyasa, style de pratique dynamique des postures développées bien plus tard)
Les 8 branches peuvent êtres vues à la fois comme des aspects complémentaires de la pratique et/ou comme des étapes graduelles de celle-ci.
Très peu abordé dans les Yoga Sutra, c’est pourtant l’aspect physique de la discipline
(aussi appelé Hatha Yoga) qu’on connait le plus aujourd’hui.
Point commun entre tout ces ouvrages? On ne connait le(s) auteur(s) d’aucun avec certitude.
***
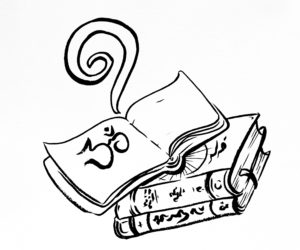
©Furiosa
A l’Inde les grands Maîtres, à leurs disciples la conquête de l’Ouest
Alors que Trimulai Krishnamachar qu’on considère comme le père du Yoga moderne, a été le maitre d’immenses yogis (ni) de notre époque tel que BKS Iyengar, Indra Devi ou Patthabi Jois, c’est d’avantage aux élèves de ces derniers que nous devons la propagation du Hatha Yoga sous diverses forme en occident à partir de 1930/1950 (date approximative).
Pour autant, certains maîtres de la seconde génération ont également contribué à l’essor du Yoga à travers le monde.
On doit notamment la très populaire « autobiographie d’un yogi » à Paramahansa Yogananda, véritable pionnier,
arrivé aux Etats-Unis dès les années 1920.
Moins populaire que son homologue Krisnamacharya bien que tout aussi influent, l’immense Sivananda Sarasvati (Swami Sivananda) écrivis plus de 200 livres auxquels la diffusion du yoga doit beaucoup, et forma de nombreux disciples talentueux .
Parmi eux, Swami Satyananda Saraswati ou encore Swami Vishnu Devananda qui a développé les ashrams et centres de Sivananda Yoga Vedanta à travers le monde entier en faisant la plus importante organisation de yoga à but non lucratif qui existe aujourd’hui. D’autres tel que Swami Satchidananda ont synthétisé et transmis aux USA le Yoga Integral.
Bien que les grandes écoles fondées par ces maîtres aient initialement transmis un enseignement complet issu du Raja yoga, les disciples de T. Krishamacharya et leurs élèves se sont d’avantage concentrés sur diverses formes de Hatha Yoga tel que le Vinyasa.
Les progrès sur le plan spirituel et psychique seraient trop difficile dans un corps souffrant ou en mauvaise santé, insistait le maître.
Il semblerait également que, tombées en désuétude en Inde dans les années 1900, les performances démonstratives ont apportées un regain d’intérêt à la pratique.
***
Du bourgeon occidental à la propagation mondiale
D’un petit noyau de pratiquants considéré comme des marginaux jusque dans les années 60, le yoga s’est par la suite démocratisé et étendu dans les pays occidentaux, tout particulièrement et en premier lieu, aux Etats-Unis.
On peut supposer que la pratique des asanas (postures) trouvant écho dans le schéma de pensée analytique et individualiste prédominant dans notre partie du monde, la porte d’entrée naturelle pour la majorité des occidentaux fut de passer par le corps.
Enthousiasmés par les exercices physiques du Yoga, leur esthétique et leurs incroyables bénéfices, nous nous les sommes partiellement appropriés et avons développés un nombre toujours croissant de «styles».
Si ils nous paraissent très différent, tous sont pourtant issus de quelques 84 postures de Hatha Yoga.
Dans la majorité des cas, cette prolifération des styles a d’avantage offert une diversification de la « façon de faire » qu’une réelle innovation: plus ou moins de rythme, de fluidité, d’alignement, un type de postures plutôt qu’un autre, un ordre différent…
Cette diversité a elle même séduite de plus en plus de pratiquants,
jusqu’à atteindre le phénomène de mode que l’on connait aujourd’hui.
***
De la démocratisation à la commercialisation
Si la diversité peut être une richesse, elle ne le devient vraiment qu’en réalisant l’unité dont elle est issue.
Aujourd’hui marketée pour répondre aux tendances et au lubies d’avantage qu’à une nécessité humaine d’expansion de conscience, le Yoga semble plus enclin à suivre les lois du marché que celle-ci.
Victime de son succès et déformée par la business culture américaine,
le Yoga en Occident s’est aujourd’hui transformé en une énorme industrie.
Des produits dérivés, textiles et abonnement en studio hors de prix, performances et compétitivité entre les institutions et parfois même entre pratiquants, formations de professeur souvent incomplètes au coût exorbitant…
Enfin et surtout, l’apparition dans notre société de l’image, d’un nouvelle étiquette « yogi(ni) » à laquelle s’identifier, d’un moule dans lequel rentrer au lieu d’une possibilité de se libérer de tout ceux qui nous accablent déjà.
Embrassant ce faux idéal, nombres de professeurs se font porte étendard d’un Yoga à leur image et à leur service,
oubliant peut être de se laisser porter par l’essence d’un héritage et de servir sincèrement sa transmission.
Si la propagation à grande échelle est un cadeau pour nous, n’y aurait-il pas quelques questions à se poser sur la façon dont nous l’avons reçue ?
Force est de constater que l’emphase sur quelques détails de la pratique physique et son expansion s’est faite en délaissant les aspect plus profonds, et en oubliant parfois du même coup le but premier du Yoga :
La libération de l’être humain de la souffrance par le cheminement spirituel et la réalisation du Soi.
Mais c’est là une autre histoire…
***
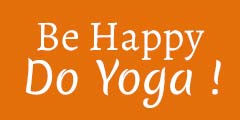
Comments 2
Article Super pertinent à l’heure où les cours de yoga les plus en vogues au États Unis sont les cours de hot yoga avec de la musique supe forte en arrière plan.
L’exercice physique est la, mais en ressort plus stresse que lorsqu’on y rentre!
Author
Merci Nicolas pour ton partage. On à effectivement tendance à mettre la corps et la performance au premier plan, si bien qu’il reste peu de place pour la conscience dans les mouvements et qu’il devient difficile d’amener de la philosophie dans la pratique. Une élève américaine de retour de vacances m’as fait un retour similaire. La meilleure solution reste de trouver la pratique qui nous convient et nottament d’équilibrer toutes les flexions arrière, les inversions et les enchainements dynamique très en vogue en ce moment, des pratiques plus douce et restoratives comme par exemple le Yin et le restorative Yoga.